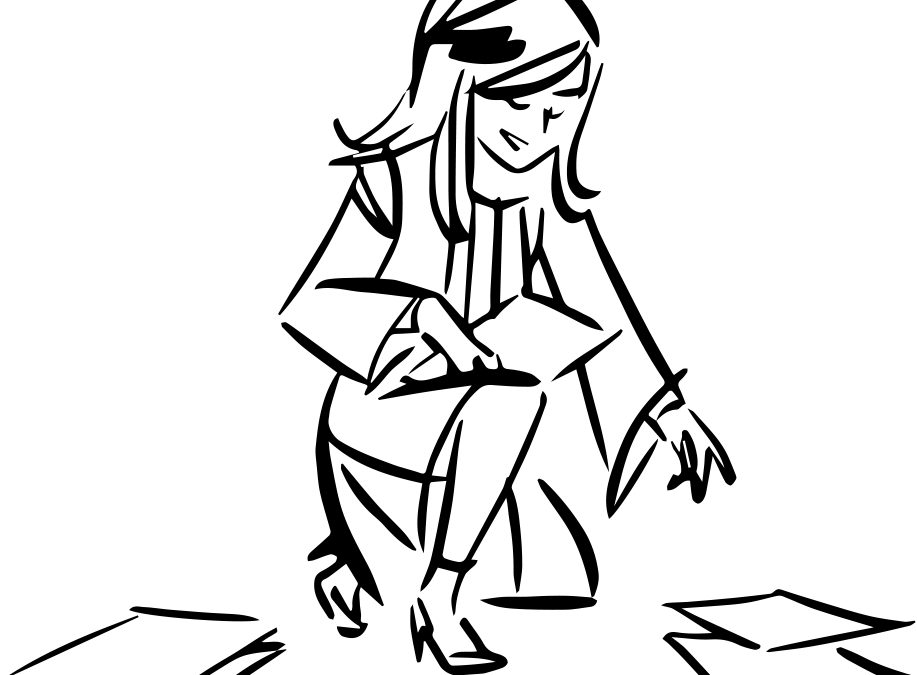Oh la la, la justice qu’est-ce qu’on va écrire ?…
Charles Picot dans son “Code Napoléon expliqué (1868)” (réédité par Hachette Livre {BNF) écrit :
”La justice est définie par : ”La volonté ferme et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû.” Le mot justice s’emploie aussi pour désigner tantôt les autorités chargées d’appliquer les lois, et tantôt le lieu où ces autorités ont coutume de prononcer leurs sentences”.
(Nous, on est un peu sidérées de voir associés :“ Justice = volonté ferme / perpétuelle / dû / autorités / loi / sentences”.)
La République française nous explique aujourd’hui :
“Qu’est-ce que la justice ? La justice désigne avant tout une valeur, un idéal moral et un concept philosophique. Elle est à la fois instinctive (le sentiment d’injustice ou de justice s’impose à nous) et complexe (il est impossible de définir abstraitement les critères du juste).
(…). L’idéal du juste est indissociable de l’activité de juger. La justice s’éprouve dans la tension qui sépare l’injuste du juste, et dans l’acte par lequel on rend la justice. Elle désigne le fait de corriger une inégalité, de combler un handicap, de sanctionner une faute. (…)
La justice et l’institution judiciaire sont distincts. L’institution judiciaire désigne les organes (les tribunaux) qui ont le pouvoir d’interpréter la loi et d’en assurer l’application. Ils tranchent entre le juste et l’injuste.”
A ce stade, on est perplexes : sous l’idée générale de Justice, voilà bien agencée la belle confusion entre justice (vérité) / juste (adéquat) / loi (droit positif * émanant des gouvernants) / juger (bien et mal) / égaliser (modifier) / sanctionner (punir) / interpréter (donner son avis) / trancher (décider).
- Le droit positif, du latin « positus » qui signifie « posé », est l’ensemble des règles et des lois en vigueur qui organisent la vie d’une société. Il s’agit donc des règles de droit qui émanent d’une autorité habilitée à les édicter, effectivement en vigueur dans un lieu et à un moment donné.
Que le droit positif * actuel (issu, donc, du Code de Napoléon) pose les fondements de la justice est l’idée parasite que nous voulons écraser.
C‘est comme si nous en étions restés à la conception de la Loi telle que définie par Piquot dans son introduction au ”Code Napoléon expliqué” puisqu’il relie :
- la loi ”règle générale de conduite, imposé par une autorité à laquelle on est tenu d’obéir”,
- à Dieu ”les lois qui émanent directement de Dieu sont celles qui illuminent tout homme venant au monde et qui restent toujours gravées dans son cœur, comme l’amour paternel, l’amour filial. Elles sont générales et immuables (…)”
- et aux lois “qui émanent indirectement de Dieu (qui) sont celles qui ont été portées par une puissance légitimement constituée. (…) Ces lois sont appelées positives”.
Cette confusion savamment orchestrée par le législateur en 1804 pour asseoir l’autorité de la loi et des tribunaux, et entretenue longtemps après prive l’humain de toute confiance en sa propre aptitude à résoudre ses problèmes en autonomie. Il suffit de se pencher sur l’impact de la loi civile actuelle sur nos comportements notamment dans la sphère intime et familiale – ce que nous nous attacherons à faire au long de ce blog -, pour voir que ce charabia est source d’une impossibilité de résoudre les situations “injustes” dans la compréhension et le respect de chacun.
Avec l’assimilation des lois et du système judiciaire à la Justice, les personnes sont conduites à aller chercher en dehors d’elles-mêmes leurs règles de conduites.
Certes, la loi devrait dans l’idéal refléter la Justice. C’est ce que l’on nous annonce avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui fait partie de notre droit puisque notre Constitution s‘y réfère ainsi que la Déclaration des droits de l’Homme de 1948.
Mais quand on y regarde de plus près, le Code civil est loin de respecter les droits fondamentaux de la personne (sans même revenir sur le fait qu’était posés les « Droits de l’homme » et non des « humains… »).
Un petit exemple :
La Déclaration des droits de l’Homme de 1948 déclare, comme droits ”sacrés” : la liberté, le droit à la sûreté de la personne, le droit de toute personne de circuler librement et de choisir sa résidence. Dans le même temps, l’article 215 du Code civil dispose que ”Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie” soit à résider dans le même domicile et à avoir des relations sexuelles (interprétation du texte par nos chers juges). Un époux qui voudrait faire appartement séparé, voire chambre à part, commettrait selon le Code civil une faute conjugale. Le mariage est donc une Institution si forte qu’elle justifie des dérogations à trois libertés fondamentales : celle de disposer de son consentement sexuel, de pouvoir choisir sa résidence et de circuler. Le résultat : des accusations sans aucun respect fondamental de l’autre au moment des séparations.
Comment amener de la lumière ? Ce qu’il y a à retenir ici, c’est que pour légiférer, nous nous attacherons chez Codecivelle à bannir toute “justice” dogmatique et dominatrice soi-disant révélatrice du bien et du mal, pour chercher “le juste”, c’est à dire à poser les bases d’une démarche éthique et éclairée permettant à la solution adéquate d’apparaître, après un examen attentif et respectueux de chaque point de vue.